Il y a une dizaine d'années encore, la littérature sur les animaux disponible en langue française se composait essentiellement de titres tels que Jeannot Lapin va à l'école ou Rosalie la tortue qui fait plouf. Les temps changent. De préoccupation puérile, la question animale est passée au rang de sujet de publications intellectuellement respectables. On évoquera ici quelques-uns des ouvrages qui en témoignent parmi ceux qui ont un lien direct avec le thème principal de ce numéro des Cahiers (la sensibilité, la conscience) : À quoi pensent les animaux ? de Marc Hauser ; Les origines animales de la culture de Dominique Lestel ; Comment l'esprit vient aux bêtes et Les animaux pensent-ils ? de Joëlle Proust [1]. On se livrera également à quelques digressions à propos de Thomas Nagel et John Searle, deux philosophes qui traitent de l'esprit de façon générale.
-Marc Hauser,
À quoi pensent les animaux ?
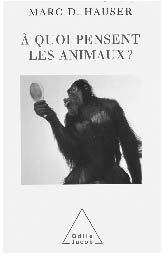 Marc Hauser est professeur de psychologie et de neuroscience à l'Université Harvard. On ne trouvera pas dans son livre la réponse à l'aguicheuse question qui en constitue le titre, mais une masse impressionnante de données sur les matériaux dont on dispose (et dont on manque) pour avancer en ce domaine. Hauser se montre très prudent dans l'interprétation des observations, terminant la plupart de ses comptes-rendus par une liste de questions qui restent en suspens et par l'énoncé des recherches qui restent à entreprendre. Cette circonspection tient à l'extrême attention portée au fait que le même comportement se prête à des interprétations plurielles, entre lesquelles il est difficile de trancher [2].
Marc Hauser est professeur de psychologie et de neuroscience à l'Université Harvard. On ne trouvera pas dans son livre la réponse à l'aguicheuse question qui en constitue le titre, mais une masse impressionnante de données sur les matériaux dont on dispose (et dont on manque) pour avancer en ce domaine. Hauser se montre très prudent dans l'interprétation des observations, terminant la plupart de ses comptes-rendus par une liste de questions qui restent en suspens et par l'énoncé des recherches qui restent à entreprendre. Cette circonspection tient à l'extrême attention portée au fait que le même comportement se prête à des interprétations plurielles, entre lesquelles il est difficile de trancher [2].
Le livre comporte trois parties. La première intitulée « connaissances universelles » traite d'outils mentaux présents chez tous les animaux. Ces outils ou capacités sont de trois ordres :
- Ceux qui permettent de reconnaître les objets et d'en prédire le comportement. Des expériences permettent de repérer que les individus ont des attentes précises concernant les objets (par exemple on peut révéler que des membres de telle espèce croient qu'un objet continue à exister alors qu'il est caché à la vue, s'attendent à ce qu'il n'y ait pas de discontinuité dans la trajectoire d'une balle, font la distinction entre objets animés et inanimés...).
- Les outils qui permettent d'évaluer un nombre d'objets ou d'événements, avec une étendue et une précision toutefois très variables selon les espèces.
- Les outils qui permettent aux animaux de se repérer dans l'espace au cours de leurs déplacements.
La deuxième partie « Les psychologues de la nature » aborde la conscience de soi, l'imitation et l'apprentissage, ainsi que les mensonges comportementaux. La dernière partie « L'esprit des animaux en société » traite de la communication (surtout sous la forme vocale) et de la question du sens moral.
À vrai dire, la connaissance de la structure du livre ne permet pas de se faire une idée très exacte de son contenu. Car, pour l'essentiel, il s'agit d'un énorme recueil d'observations de terrain et d'expériences conduites en laboratoire, portant sur des espèces et des thèmes très divers. En voici un exemple parmi beaucoup d'autres. Il est assez représentatif de la méthode de Hauser, qui est lui même psychologue expérimental, et qui utilise souvent comme point de comparaison les réactions du nourrisson ou du jeune enfant humain.
Imaginez un cadre rectangulaire posé verticalement. Sur le montant du haut sont fixés trois tubes creux (A, B, C). Sur le montant du bas, sous chaque tube, sont posées trois boîtes 1, 2, 3. Il reste un espace vide entre les tubes et les boîtes. On présente le dispositif au sujet, et on installe devant lui un tube opaque oblique allant du tube A à la boîte 3. Ce système a pour but de révéler ce que le sujet sait ou croit concernant la chute des corps. Il a servi à étudier des tamarins (petits singes) et de jeunes humains. Sous les yeux du sujet on insère une balle (enfant) ou un aliment (tamarin) dans le tube A et on regarde dans quelle boîte il va chercher l'objet. Les tamarins adultes et les enfants de deux à trois ans réagissent de la même manière : ils cherchent dans la boîte 1, celle qui est sous le tube A. Ils refont la même erreur vingt à trente fois quand on répète l'expérience, alors qu'à la fin de chacune, on leur montre que l'objet est dans la boîte 3. Si on remplace le tube opaque oblique par un tube transparent, de façon à ce qu'ils voient le déplacement de la balle ou de l'aliment, ils trouvent la bonne réponse (boîte 3). Mais étrangement, si ensuite on installe à nouveau le tube opaque, ils reviennent à leur ancienne erreur. Comment interpréter cela ? Hauser parle d' « erreurs kuhniennes [3] ». Ces réactions révèlent que les sujets possèdent des théories physiques, des attentes sur la façon dont les choses devraient se passer, en l'occurrence la croyance « un objet tombe verticalement ». Ces théories sont des outils précieux pour les guider dans leur comportement face à l'environnement, et ils ont du mal à renoncer à interpréter le monde selon les « lois » qui leur sont familières, même si les faits leur donnent tort. En grandissant, les enfants humains apprennent que les objets peuvent être déviés, et comprennent pourquoi. Les tamarins adultes restent persuadés que les objets se dirigent toujours directement vers le sol, et ne croient à une autre trajectoire que s'ils la constatent visuellement.
Le livre de Hauser est une mine de récits de ce genre, présentés de façon à la fois précise et distrayante.
Dominique Lestel,
Les Origines animales de la culture
 On peut lire Les origines animales de la culture pour se documenter sur différents aspects de la vie sociale des animaux ; les travaux recensés sont nombreux. Mais l'ouvrage contient plus que cela. Dominique Lestel est à la fois philosophe et éthologue. Cette double compétence se traduit par l'attention portée aux concepts (culture, outil, langage...) et par la référence à des débats qui engagent tant des éthologues que des philosophes et spécialistes de sciences humaines (j'en donnerai un exemple avec l'évocation par l'auteur des controverses autour de l'imitation). Il faut savoir enfin que Lestel a une thèse propre à défendre sur la question de la culture.
On peut lire Les origines animales de la culture pour se documenter sur différents aspects de la vie sociale des animaux ; les travaux recensés sont nombreux. Mais l'ouvrage contient plus que cela. Dominique Lestel est à la fois philosophe et éthologue. Cette double compétence se traduit par l'attention portée aux concepts (culture, outil, langage...) et par la référence à des débats qui engagent tant des éthologues que des philosophes et spécialistes de sciences humaines (j'en donnerai un exemple avec l'évocation par l'auteur des controverses autour de l'imitation). Il faut savoir enfin que Lestel a une thèse propre à défendre sur la question de la culture.
Une source documentaire
Ce livre constitue une bonne source d'information en deux domaines. On y trouvera d'abord une histoire des conceptions humaines de l'intelligence animale qui visite de nombreux auteurs, en partant de Descartes, pour passer par les théories évolutionnistes, le béhaviorisme, la sociobiologie, et en arriver à l'éthologie moderne.
La culture est un sujet dont le traitement révèle particulièrement bien l'inadaptation des partitions en vigueur parmi les sciences. La tradition réside dans une séparation forte entre d'un côté les sciences de l'animal, domaine de la biologie, et de l'autre les sciences de l'homme, domaine de l'ethnologie et de la sociologie. D'un côté des disciplines descriptives saisissant des objets, de l'autre des disciplines interprétatives, réservées à l'étude des sujets.
L'idée d'ouvrir les sciences sociales à l'animal se heurte à deux obstacles. « Le premier vient de notre image de l'animal, massivement formée par les sciences naturelles, au point d'en être littéralement déformée. Le deuxième vient des sciences sociales elles-mêmes, qui s'érigent comme les sciences mêmes de la discontinuité entre l'homme et l'animal » (p. 310). Des brèches ont pourtant été ouvertes dans cette division. C'est surtout l'éthologie de terrain basée sur des études de longue durée qui retient l'attention de Lestel. Les primatologues japonais dès les années 50, puis les occidentaux, ont entrepris d'étudier les sociétés de singes en adoptant un point de vue ethnographique, et ont produit des informations d'une grande richesse sur le rôle des structures de parenté, la violence et la réconciliation, les comportements de partage... tout en mettant en évidence des attitudes qui semblent relever de l'amitié ou de la compassion. Des études de ce type se sont étendues à d'autres espèces [4] (dauphins, éléphants, oiseaux, cétacés...).
Les origines animales de la culture recense les apports de ces travaux. On y trouve en particulier de nombreuses données sur l'utilisation intelligente d'outils (ou plus généralement de « médiateurs de l'action ») ou encore sur les études relatives à la communication vocale. Lestel souligne en outre le caractère prometteur de deux domaines encore peu explorés à ce jour : celui du jeu, présent chez de nombreuses espèces, et celui de l'éventuelle existence d'un sens esthétique chez les animaux.
La plupart des comportements évoqués font intervenir des rapports sociaux, et les éthologues en sont arrivés à parler de culture animale, suscitant une forte résistance de la part des anthropologues qui « n'arrêtent pas d'expliquer que si les humains ont des cultures (et eux seuls, ajoutent-ils in petto...) c'est parce que l'homme a un système de communication d'une complexité adéquate - le langage (p. 12) ». Pourtant, il est maintenant acquis qu'il existe chez plusieurs espèces des différences de comportement entre les groupes, qui ne s'expliquent ni par des différences de l'environnement, ni par des différences génétiques. Ces spécificités supposent une capacité d'innovation, et la transmission des pratiques acquises entre les générations. On a découvert par exemple de multiples variations à l'intérieur de la culture matérielle des chimpanzés, qui concernent aussi bien les types d'outils utilisés, que les modalités d'épouillage, les techniques de chasse, ou encore le régime alimentaire (les types de végétaux consommés). Non moins spectaculaires sont les résultats des primatologues japonais à propos des populations de macaques. En 1953, ils observent l'invention par une femelle de la technique de lavage des patates douces dans l'eau, puis de lavage du blé (en jetant le blé dans l'eau, le sable qui s'y trouve mêlé coule, et il ne reste plus qu'à recueillir les grains qui flottent à la surface). Ces innovations sont l'occasion de suivre la façon dont une technique se répand chez les autres membres de la troupe, et de voir le rôle que jouent l'âge, le sexe ou les relations de parenté. Comme pour les chimpanzés, on trouve chez les macaques des pratiques différentes selon les groupes (dans une seule bande, les mâles se masturbent ; certains groupes consomment des œufs et d'autres pas...). Si les sociétés de primates sont celles qui ont été le plus étudiées, des différences culturelles à l'intérieur de la même espèce ont également été mises en évidence chez d'autres types de singes, des cétacés, des rats, diverses espèces d'oiseaux...
Débats autour de l'imitation
Les différences de comportements entre groupes d'individus de la même espèce et leur permanence au cours du temps supposent l'existence de mécanismes de transmission. Une des voies qui ont été empruntées pour nier qu'il s'agisse de véritables cultures a été de contester que la transmission se fasse par imitation ou par enseignement. Cette tradition, dont on trouve des représentants dès les années 1930 (avec la notion de renforcement de stimuli), est reprise par le psychologue Michael Tomasello dans les années 1990 qui parle d'émulation, une forme de transmission où l'animal est influencé par l'action de ses congénères, mais où il n'imite pas une méthode, ni ne comprend les intentions de l'autre. Lestel conteste surtout la validité de cet argument pour s'opposer à la notion de culture animale : « Les cultures humaines sont fondées sur des mécanismes d'apprentissage, d'enseignement et d'imitation qui sont propres aux humains, mais elles ne sont pas représentatives du phénomène culturel à son niveau le plus général » (p. 158). Mais il fournit aussi des données montrant qu'aujourd'hui beaucoup d'inconnues demeurent sur les voies de la transmission culturelle. La lenteur de propagation de certaines pratiques dans un groupe et la lenteur d'apprentissage de certains gestes dans la relation mère-enfant alimentent des thèses comme celle de Tomasello. Mais en sens inverse, on a bien observé chez des singes des comportements qui sont de l'ordre de l'imitation, et aussi des occurrences, rares mais difficilement contestables, d'enseignement (dans les rapports mère-enfant), c'est-à-dire des comportements qui supposent que l'enseignant a l'idée de la bonne méthode à utiliser, qu'il compare sa façon d'agir à celle de l'enseigné, et où il intervient de façon à corriger le geste de l'enseigné, ce qui suppose de sa part une anticipation de l'influence de sa démonstration sur l'élève. D'autre part, note Lestel :
Chez [l'humain], le véritable enseignement n'est d'ailleurs pas aussi fréquent qu'on le croit. Une étude des enfants au Nigéria et en Angleterre permet d'en douter ; elle décrit des mères qui n'enseignent quelque chose à leurs enfants que dans 0,1% de toutes leurs interactions avec eux. Dans le contexte du cassage de noix à Taï, les chimpanzés pratiquent six fonctions d'aide que l'on retrouve dans l'enseignement humain : le recrutement (le modèle attire l'attention de l'enfant sur une tâche), l'échafaudage (le modèle simplifie la tâche en réduisant le nombre d'actes requis pour atteindre la solution), la maintenance de direction (le modèle soutient l'intérêt de l'enfant dans la recherche de la solution), le marquage des caractéristiques critiques (le modèle accentue certaines caractéristiques de la tâche), le contrôle de la frustration (le modèle rend plus facile la recherche de la solution), la démonstration (le modèle fournit à l'enfant de l'information sur la façon d'effectuer une tâche (p. 156-157).
J'ai choisi cet exemple parmi bien d'autre sujets sur lesquels Lestel rapporte des observations et des controverses ou hésitations quant à leur interprétation, parce que celui-là est un aspect d'une discussion plus générale sur la capacité (ou l'incapacité) des animaux non humains à se représenter les méthodes et buts de leurs actions, et à comprendre que les autres sont comme eux des être doués d'intentions. Dans le même registre, on peut lire avec profit les résultats de travaux sur les primates rapportés par Steven Wise dans Rattling the Cage [5]. Le primatologue Daniel Povinelli a par exemple conduit une série d'expériences dans les années 90, dont il a conclu que les chimpanzés n'ont pas la notion de cause et d'effet, ne peuvent pas désigner un objet du doigt, et ne sont pas capables de manifester des comportements élémentaires prouvant qu'ils ont conscience de l'intentionalité des autres. D'autres primatologues (dont Juan Carlos Gómez [6] et Sue Savage-Rumbaugh) ont contesté la validité de ses thèses, mettant en cause les failles de la procédure expérimentale mise œuvre par Povinelli. Je referme cette parenthèse, car développer plus avant serait hors de propos dans un compte-rendu de lecture. Cependant, la place qu'est en train de prendre dans la littérature l'hypothèse selon laquelle la capacité d'empathie, ou la capacité d'accès à l'esprit de l'autre, constitue le propre de l'homme est certainement un sujet qui mériterait que l'on y réfléchisse plus avant.
La thèse de Dominique Lestel
Bien que « la conviction que l'animal est une espèce de robot perfectionné reste la conception dominante chez les scientifiques qui s'intéressent à lui » (p. 327), les travaux sur la culture animale ont commencé à miner cette vision des choses. Cependant, on n'a pas encore pris la mesure de « la nécessité face à laquelle nous nous trouvons désormais de devoir penser le phénomène culturel dans une perspective évolutionniste et pluraliste, et non plus poussés par la volonté de dégager « le propre de l'homme » une fois pour toutes. Il ne faut plus penser la culture en opposition à la nature mais prendre conscience de la pluralité des cultures chez des créatures d'espèces très différentes » (p. 8).
Selon Lestel, la raison principale pour laquelle on n'a pas encore compris la portée des bouleversements en cours est que l'on n'a pas saisi à quel point il est essentiel de repenser l'animal comme sujet :
Une culture se distingue de la société par la complexité des phénomènes sociaux mis en jeu et par la transformation de l'animal impliqué en sujet. C'est la thèse centrale du livre. Il n'y a pas de culture sans sujet [...] et il y a des espèces de sujets chez les animaux. C'est la révolution de l'éthologie contemporaine. Qu'elle reste inaperçue, y compris chez la plupart des éthologues, est à verser sur le compte de l'ironie divine (p. 330).
Pour asseoir l'affirmation qui constitue sa « thèse centrale », Lestel se tourne vers la philosophie. C'est l'objet du chapitre 5 de son livre que lui même désigne comme « le plus important » (p. 12). Dans ce chapitre, il se propose, à travers la présentation d'une sélection d'auteurs du XXe siècle (Jacob von Uexküll, Frederik J. Buitendijk, Adolf Portman, Hans Jonas) d'enrichir notre réflexion sur la culture et la subjectivité animales. Malgré la sympathie que m'inspire le projet faire reconnaître l'animal comme sujet, j'avoue être restée hermétique à l'apport de ce chapitre. Je n'ai pas saisi en quoi l'intérêt de Portman pour l'apparence, la couleur ou la symétrie des parties visibles d'un animal apportait un éclairage décisif sur la culture. Quant aux trois autres auteurs présentés, ils ont déclenché chez moi l'allergie à un certain style de philosophie germanique. Les lois de l'évolution m'ont pourvue d'oreilles qui n'arrivent à y percevoir que phraséologie. Il est possible que des lecteurs mieux dotés par la nature réussissent à extraire de ce chapitre quelques pistes de réflexion intéressantes.
Quoi qu'il en soit, je peux témoigner que même (ou surtout ?) amputé de son chapitre 5, Les origines animales de la culture est un livre recommandable.
Joëlle Proust [7] et l'esprit des bêtes
 Les animaux pensent-ils ? est un petit livre, de la dimension d'un gros article. Petit mais costaud. Amateurs de lectures délassantes, passez votre chemin. Ce livre est néanmoins plus abordable (et contient proportionnellement plus de passages consacrés aux animaux) que son prédécesseur Comment l'esprit vient aux bêtes dont il n'est pour l'essentiel qu'une version abrégée [8]. On s'appuiera indifféremment sur la version longue (1997) et sur la version courte (2003) dans ce qui va suivre. Pour donner une idée de leur contenu, je procéderai en partant de ce qu'on saisit immédiatement par une lecture superficielle, pour progresser vers des composantes plus fondamentales de l'analyse de Proust.
Les animaux pensent-ils ? est un petit livre, de la dimension d'un gros article. Petit mais costaud. Amateurs de lectures délassantes, passez votre chemin. Ce livre est néanmoins plus abordable (et contient proportionnellement plus de passages consacrés aux animaux) que son prédécesseur Comment l'esprit vient aux bêtes dont il n'est pour l'essentiel qu'une version abrégée [8]. On s'appuiera indifféremment sur la version longue (1997) et sur la version courte (2003) dans ce qui va suivre. Pour donner une idée de leur contenu, je procéderai en partant de ce qu'on saisit immédiatement par une lecture superficielle, pour progresser vers des composantes plus fondamentales de l'analyse de Proust. 
Conscience animale et éthique
Dès les premières lignes de Les animaux pensent-ils ?, Proust évoque les enjeux éthiques d'une réponse positive à la question de l'existence d'une conscience animale [9] :
Les animaux pensent-ils ? Sont-ils conscients ? [...] S'ils sont conscients, ne faut-il pas les traiter autrement que nous ne l'avons fait depuis des siècles : comme des bêtes de somme, des esclaves, des cibles vivantes, et, bien sûr, comme des fournisseurs de viande, de peaux, de médicaments ? Et si notre survie dépend de leur exploitation, n'avons-nous pas au moins à respecter certains droits élémentaires liés à la qualité de leur vie ? [...] La question de la conscience animale a pris un tournant éthique : on ne peut plus se contenter de réponses vagues ou purement empathiques (Proust, 2003, p. 7-8).
Passées les trois premières pages cependant, l'auteure ne revient plus sur la maltraitance des animaux, et ne prend aucune position sur la question éthique qu'elle a soulevée. La raison n'en est pas forcément que le sujet lui est indifférent. Il arrive à Proust d'employer les expressions « spécisme » ou « animal non humain ». Un thème récurrent dans ses écrits est par ailleurs celui du rejet de l'anthropomorphisme. Alors que chez d'autres il s'agit d'un épouvantail agité pour discréditer toute sollicitude envers les animaux, chez elle il sert plutôt à affirmer le refus d'identifier l'esprit avec la forme particulière qu'il revêt chez les humains. C'était déjà le sens de la critique qu'elle adressait au GAP en 2000 [10], lui reprochant son caractère spéciste (privilégier les animaux qui ressemblent le plus aux humains).
Les animaux ont-il un esprit ?
La conclusion de Proust est que tous les vertébrés possèdent un esprit. Quant aux invertébrés, ils ne sont pas relégués dans la catégorie des choses, mais occupent une sorte de position intermédiaire [11].
L'auteure réfute certains des arguments discontinuistes utilisés pour nier la conscience animale, notamment à travers la discussion des thèses de Davidson [il n'y a pas de pensée chez l'animal, faute de concepts qui exigent la possession d'un langage] ou Carruthers [les animaux ne sont pas conscients parce qu'ils n'ont pas de conscience réflexive : ils n'ont pas de métareprésentations]. Contre ces auteurs, Proust expose la possibilité d'une pensée conceptuelle non verbale, dont l'existence n'est pas compromise par la non-maîtrise des concepts se référant aux états mentaux eux-mêmes (comme « ressentir » ou « désirer »).
À d'autres égards, Proust se montre extrêmement parcimonieuse dans l'attribution de facultés mentales aux animaux. Disons pour aller vite qu'elle est très « Tomasello-Povinelli », et que ses écrits contiennent une série assez longue d'affirmations étrangement catégoriques, à de rares nuances près, sur ce dont les animaux sont incapables : chez eux, pas d'imitation, pas d'enseignement, pas de compréhension de la causalité physique, ni de la causalité psychologique (ils ne savent pas qu'ils ont un esprit, ni que les autres en ont un ; ils ne prêtent pas d'intentions, croyances ou sentiments à autrui), pas de capacité sauf exceptions à inventer des signaux nouveaux pour communiquer...
Que les conceptions les plus étroites de la vie mentale des animaux aient sa faveur a peut-être un rapport avec le fait que le but de sa recherche est d'établir les conditions minimales pour pouvoir dire d'un organisme qu'il possède un esprit, et que ces conditions n'exigent aucune des capacités énumérées ci-dessus.
Les conditions minimales pour avoir un esprit
Un être possède un esprit selon Proust s'il est capable de former des représentations. Considérons un organisme et son environnement. Cet organisme a des représentations s'il est capable de produire des événements ou des états internes qui « sont le signe », qui « correspondent à » des objets ou des événements extérieurs (ou à certaines de leurs propriétés). La correspondance ne doit pas être une simple covariation. Ce n'est pas parce que le mercure se dilate avec la température que le thermomètre se représente la chaleur. Que faut-il donc de plus ? Proust ajoute une condition d'objectivité dans la relation d'un système à son environnement. Pour avoir un esprit, un organisme doit être capable de saisir un objet comme « détaché » de lui, comme existant indépendamment de l'effet produit sur les récepteurs au moyen desquels il capte sa présence. Sa représentation de l'objet ne se confond pas avec l'état d'un récepteur. La faculté représentationnelle renvoie donc à une certaine manière d'extraire, de traiter et d'utiliser des données relatives à l'environnement. Les conditions minimales pour avoir un esprit sont les suivantes :
- L'organisme doit posséder au minimum deux sources pour capter des données extérieures, deux types de récepteurs sensoriels (le toucher et l'odorat par exemple).
- Les données provenant de ces deux sources doivent pouvoir être comparées, et au besoin « recalibrées », c'est-à-dire que l'organisme doit pouvoir détecter une incohérence entre des informations provenant de différents récepteurs, et les traiter de façon à rétablir la cohérence. Un aspect important pour pouvoir parler de représentation est donc la possibilité de « méreprésentation » (d'erreur dans la description de l'objet ou événement externe créée à partir des récepteurs, et d'existence d'une possibilité de correction de cette description).
Un exemple permettra de mieux comprendre le sens de ces conditions. La chouette effraie prélève des données sur la position d'une proie par deux canaux : la vue et l'ouïe. Son système nerveux est tel que ces deux entrées sont mises en relation entre elles puisqu'elle possède des neurones activés à la fois par les perceptions auditives et visuelles. À partir du traitement d'informations issues de ces deux sources, il se forme une représentation de l'objet extérieur (la proie). Si l'on met des tampons dans les oreilles de la chouette, le signal sonore est amoindri, de sorte que l'ouïe et la vue donnent des informations incompatibles sur la position de la proie. Or, on observe que la chouette s'adapte à cette nouvelle situation ; les données auditives sont recalibrées de façon à devenir cohérentes avec les données visuelles. En clair : la chouette arrive à atteindre ses proies avec des oreilles partiellement bouchées. Cela indique qu'elle a les moyens de traiter un objet extérieur comme extérieur (elle ne le confond pas avec les signaux « proximaux » de ses récepteurs sensoriels), et de corriger (mettre en cohérence) les informations qu'elle reçoit à son sujet.
Ces conditions suffisent à caractériser la formation de représentations telle qu'elle est définie par Proust. Il manque cependant au tableau une dimension importante de son analyse de l'esprit animal, qui a trait à l'utilisation des informations extraites de l'environnement. Pour l'auteure, la capacité représentationnelle est une fonction biologique. En matière de biologie, les emprunts à la théorie de l'évolution, ou à la sociobiologie, occupent une assez large place dans sa réflexion, avec pour idée directrice que la capacité à former des représentations a pour fonction de conférer aux êtres qui la possèdent une aptitude accrue à la reproduction.
La possession de concepts reconnue aux animaux est une façon alternative d'exprimer leur capacité représentationnelle et sa fonction. Bien qu'ils n'aient pas de langage, les animaux sont aptes à se comporter comme s'ils tenaient des raisonnements du type suivant :
Cet objet est un A
Les A ont pour propriétés d'être P, Q, R
P est une propriété utile pour moi
Je vais consommer cet objet (Proust 2003, p. 32).
En résumé, l'analyse proposée par Proust de l'esprit animal a pour pièces maîtresses la représentation, l'objectivité et la fonction adaptative. Objectivité dans le sens de capacité de l'animal à traiter l'information comme se rapportant à un objet indépendant de lui. Mais objectivité aussi dans la position du chercheur vis à vis de la question de la conscience. Nous n'avons pas encore abordé ce second aspect, pourtant capital. Peut-être vaut-il la peine d'en noter les conséquences avant d'en aborder les causes.
Fausse joie
Faisons le point.
(1) Tous les courants de la philosophie éthique font de la conscience une condition nécessaire pour faire partie des patients moraux (condition nécessaire et suffisante dans le cas de l'utilitarisme). Seuls font exception des courants holistes tels que l'écologie profonde qui accordent une valeur intrinsèque au « grand tout » (les écosystèmes, la terre...).
(2) Joëlle Proust déploie des trésors de culture et d'intelligence pour parvenir à la conclusion que tous les animaux vertébrés sont conscients. De surcroît, elle évoque elle-même les enjeux éthiques du problème.
Certes, elle ne va pas jusqu'à prendre clairement position sur les conséquences pratiques que les humains devraient en tirer quant à leur comportement envers les bêtes ; mais il semble qu'elle ait fait l'essentiel du travail, et que nous n'ayons plus qu'à nous appuyer sur ses conclusions pour boucler la boucle : tous les vertébrés doivent bénéficier de la considération morale, et non pas les seuls humains.
Mais cette impression ne tient que parce que, spontanément, nous attribuons au mot « conscience » le sens qu'il a dans la langue courante. Si Proust avait démontré que les animaux sont conscients dans ce sens-là, son apport serait effectivement précieux. Malheureusement, il n'en est rien, car elle a entièrement redéfini les mots « conscience » ou « esprit ». Pour échapper à l'illusion, il suffit de désigner l'esprit au sens de Proust par un autre mot, disons « glarf », et de balayer tout ce qui dans l'exposé de sa thèse évoque les animaux avec la vie mentale qu'on leur attribue intuitivement, mais qui en fait n'est pas nécessaire à son argumentation (oublions les noms tels que « organisme », « chouette », ou les adjectifs tels que « perceptif » ou « sensoriel »). Que reste-t-il ? Ceci :
Un système possède un glarf s'il prélève des données sur un point de son environnement par deux entrées différentes, les transforme de façon à ne pas associer à ce point des coordonnées incompatibles, et utilise le résultat de ce traitement pour produire des sorties motrices qui favorisent sa reproduction.
Existe-t-il une seule raison de se soucier d'agir moralement envers de telles entités ? Je n'en vois aucune. Ce serait tout aussi absurde que de désigner comme patients moraux, par exemple, les systèmes qui sont organisés de telle sorte qu'ils réfléchissent la lumière de façon à minimiser leur réchauffement.
Il en va tout autrement du critère de la conscience, entendue au sens usuel. Un être est conscient si au minimum il éprouve des sensations, des émotions. Plus largement, nous associons à la vie mentale des notions telles que désirer, décider, croire, comprendre, se remémorer etc. Retenir les êtres qui présentent ce type de caractères comme candidats à la patience morale semble justifié, contrairement aux critères précédemment évoqués. Un être conscient, au sens ordinaire, possède des traits tels que nous soucier d'agir pour son bien a un sens, parce que « son bien » est une réalité du point de vue de cet être lui-même, ce qui n'est pas le cas pour une entité insensible.
La façon dont une thèse volumineuse consacrée à la conscience en arrive à escamoter la conscience mérite d'être examinée plus avant, car Joëlle Proust est loin d'être un cas particulier.
Chauve-souris
et autres chambres chinoises
Le fantôme de la chauve-souris
 En 1974, le philosophe Thomas Nagel publiait un article intitulé « What is it like to be a bat [12] ? ». Il a assuré la gloire à son auteur si on mesure la réussite au nombre de fois où un texte est cité, mais pourrait également figurer au livre des records pour le nombre de fois où il n'a pas été compris. Je l'ai souvent vu « résumé » par l'idée que nous ne pouvons imaginer en rien ce qui constitue l'expérience subjective d'un animal, ou pire par : « la vie mentale des animaux est inintelligible pour nous, donc ils n'ont pas de vie mentale » (alors que Nagel dit explicitement ne pas douter qu'ils en aient une). Proust ne se rend pas coupable cette déformation scandaleuse. Le fantôme de la chauve-souris hante néanmoins ses écrits, dans le rôle du repoussoir : Nagel incarne à ses yeux les approches stériles de l'esprit, par opposition à l'analyse constructive qu'elle propose. Il est promu chef de file du « mystérianisme », courant qui condamnerait l'étude de l'esprit animal à rester dans l'impasse. La grande faute de cet auteur est d'estimer que « L'esprit est essentiellement le pouvoir de penser en première personne, c'est-à-dire d'avoir un point de vue subjectif et qualitatif sur le monde » ; or, « les états conscients propres à l'homme ne peuvent pas lui permettre d'accéder par analogie aux faits de conscience propres à d'autres espèces. En effet, ces types d'expérience des individus d'autres espèces sont gouvernés par des organes sensoriels et des intérêts vitaux trop éloignés des nôtres pour que nous puissions y avoir accès sur un mode subjectif. Conclusion : la question de l'esprit animal ne pourra jamais être résolue et, de ce fait, on n'aura jamais de théorie générale de l'esprit. » (Proust, 2003. p. 14-15)
En 1974, le philosophe Thomas Nagel publiait un article intitulé « What is it like to be a bat [12] ? ». Il a assuré la gloire à son auteur si on mesure la réussite au nombre de fois où un texte est cité, mais pourrait également figurer au livre des records pour le nombre de fois où il n'a pas été compris. Je l'ai souvent vu « résumé » par l'idée que nous ne pouvons imaginer en rien ce qui constitue l'expérience subjective d'un animal, ou pire par : « la vie mentale des animaux est inintelligible pour nous, donc ils n'ont pas de vie mentale » (alors que Nagel dit explicitement ne pas douter qu'ils en aient une). Proust ne se rend pas coupable cette déformation scandaleuse. Le fantôme de la chauve-souris hante néanmoins ses écrits, dans le rôle du repoussoir : Nagel incarne à ses yeux les approches stériles de l'esprit, par opposition à l'analyse constructive qu'elle propose. Il est promu chef de file du « mystérianisme », courant qui condamnerait l'étude de l'esprit animal à rester dans l'impasse. La grande faute de cet auteur est d'estimer que « L'esprit est essentiellement le pouvoir de penser en première personne, c'est-à-dire d'avoir un point de vue subjectif et qualitatif sur le monde » ; or, « les états conscients propres à l'homme ne peuvent pas lui permettre d'accéder par analogie aux faits de conscience propres à d'autres espèces. En effet, ces types d'expérience des individus d'autres espèces sont gouvernés par des organes sensoriels et des intérêts vitaux trop éloignés des nôtres pour que nous puissions y avoir accès sur un mode subjectif. Conclusion : la question de l'esprit animal ne pourra jamais être résolue et, de ce fait, on n'aura jamais de théorie générale de l'esprit. » (Proust, 2003. p. 14-15)
Certes, Nagel évoque l'exemple de la chauve-souris pour illustrer l'incapacité à connaître la « saveur » de l'expérience sensible d'un être différent de nous (nous ne savons pas l'impression que cela fait de se guider par écholocation). Mais son texte n'est ni un documentaire sur les chauve-souris, ni une thèse sur l'inaccessibilité de l'esprit animal (la même idée est illustrée dans son article par la difficulté pour un humain aveugle d'imaginer l'impression que cela fait d'être un humain voyant). Son propos est d'insister sur la réalité du vécu subjectif, et d'attirer l'attention sur son caractère irréductible : lorsqu'on étudie la vie consciente objectivement (c'est-à-dire de l'extérieur, dans une relation entre un observateur et un objet d'étude) on réduit le phénomène étudié à certaines composantes et relations causales, et ce faisant on perd quelque chose, on fait disparaître la nature même du phénomène.
Le but de Nagel n'est pas de contester l'intérêt de l'étude scientifique du mental [13], mais de souligner que le ressenti échappe à la réduction [14]. L'exemple de la chauve-souris montre ceci : nous pouvons décrire un sonar en tant que moyen d'avoir une perception en trois dimensions ; il se peut que nous arrivions à une connaissance très fine des centres perceptifs et neuronaux impliqués dans l'écholocation ; mais cela ne suffit pas pour savoir l'impression que cela fait « de l'intérieur » à une chauve-souris de se repérer au moyen d'un sens que nous ne possédons pas.
En résumé, Nagel constate que l'approche objective n'épuise pas le réel et se demande s'il est concevable qu'elle y parvienne un jour, ou si les points de vue objectif et subjectif sont définitivement irréconciliables. Son texte est aussi une protestation contre une grande partie de la philosophie contemporaine qui « résout » le problème de l'irréductibilité du mental par l'élimination pure et simple du caractère subjectif de la vie consciente :
Comme le reste du genre humain, les philosophes ont la faiblesse de céder au penchant qui nous pousse à expliquer ce qui est incompréhensible dans des termes adaptés à l'explication de choses familières et bien comprises, mais totalement différentes. Cela a conduit à accepter des façons très peu plausibles de rendre compte du mental, principalement parce qu'elles rendent possibles des formes familières de réduction. [...] Les aspects les plus importants et les plus caractéristiques des phénomènes mentaux sont très mal compris. La plupart des théories réductionnistes n'essaient même pas de les expliquer (Mortal Questions, p. 166).
Une grande partie du néo-béhaviorisme présent dans la psychologie philosophique récente résulte de l'effort accompli pour remplacer l'esprit réel par un concept objectif de l'esprit, afin qu'il ne reste rien qui ne puisse être réduit (op. cit. p. 175).
Joëlle Proust est une représentante des courants philosophiques visés par Nagel dans ce passage, de la mouvance « fonctionnaliste ». On peut leur attribuer comme ancêtre commun le béhaviorisme en cela qu'il a pour caractéristique de refuser toute référence à la psychologie, réduisant l'analyse du comportement animal à des relations rigides entre des input (les stimuli) et des output (les mouvements). Cette approche est aujourd'hui unanimement récusée. Cependant, Nagel voit juste quand il parle de néo-béhaviorisme. Certes, les auteurs modernes introduisent de la flexibilité et des chaînons intermédiaires dans le rapport input/output ; ils sont attentifs au fait que la même fonction peut-être assurée par des supports biologiques différents ; ils alimentent leur discours d'emprunts aux apports de l'intelligence artificielle... Mais le fond demeure : le cheminement explicatif qui permet de passer d'un input sensoriel à un output moteur est soigneusement expurgé de toute référence à la subjectivité [15].
La chambre chinoise de John Searle
Présenté pour la première fois en 1980 et repris dans plusieurs de ses écrits ultérieurs (voir notamment le chapitre 1 de The Mystery of Consciousness), cet argument de Searle vise à contester la position de « l'intelligence artificielle forte » selon laquelle la pensée naît de l'exécution d'opérations formelles appropriées (Si un ordinateur simule correctement la connaissance consciente d'un humain, alors il est conscient). L'argument s'inscrit dans le cadre de la critique par Searle des approches qui assimilent l'esprit à un programme (software) et le cerveau à la machine qui l'exécute (hardware).
Imaginons un Anglais qui ne connaît que sa langue maternelle. Il est enfermé dans une pièce avec à sa disposition des caisses contenant des idéogrammes chinois. Il dispose également d'un livre (le programme) qui lui fournit les règles de passage d'une séquence de lettres chinoises à une autre séquence (ces lettres et leurs combinaisons ne sont pour l'Anglais que des dessins qu'il reconnaît à leur forme). De l'extérieur, on lui fait passer des paquets ordonnés d'idéogrammes ; ensuite, au moyen des règles contenues dans le livre, l'Anglais fournit en retour un autre paquet d'idéogrammes. Du point de vue d'un Chinois, situé hors de la pièce, les paquets entrants sont des questions et les paquets sortants des réponses (réponses correctes si le programme est bien conçu). L'Anglais dans cette histoire joue le rôle d'un ordinateur exécutant un programme. Or, même si les séquences qu'il produit sont pour le Chinois des phrases intelligibles, l'Anglais ne comprend pas la langue chinoise. La conclusion de cette histoire est que la capacité à appliquer des règles formelles (l'exécution d'un algorithme) n'est pas une condition suffisante pour posséder un esprit. Une dimension essentielle fait défaut pour qu'on puisse parler de conscience : les opérations réalisées n'ont pas de sens pour le système qui les effectue. Pour l'Anglais (ou l'ordinateur) les objets qu'il manipule ne sont pas des symboles, et les règles opératoires ne sont pas une syntaxe.
Un état de conscience est intrinsèque : mon état mental existe pour moi, indépendamment de ce que d'autres pensent. S'agissant d'un ordinateur, seules certaines propriétés physiques lui sont intrinsèques, les impulsions électriques par exemple. Mais ces impulsions électriques, ou leur résultat, ne sont perçues comme un calcul ou comme des propositions douées de sens que si elles sont interprétées par des sujets conscients. Les opérations d'un ordinateur ne prennent une valeur sémantique que du point de vue d'un observateur extérieur.
(Précisons que Searle ne soutient pas qu'il est inconcevable que l'on construise un jour des machines pensantes. Son propos est d'expliquer en quoi, selon lui, les sciences cognitives inspirées de l'intelligence artificielle font fausse route).
Du côté de chez Searle
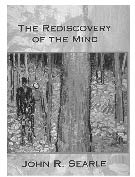 Je me suis demandé si je ne faisais pas un mauvais procès à Joëlle Proust en la soupçonnant d'avoir redéfini la notion d'esprit. N'adopte-t-elle pas plutôt une approche objective (extérieure) de l'esprit par nécessité, avec cependant pour projet d'œuvrer à la détection et la compréhension des états conscients comme expérience qualitative ? Voudrait-elle dire qu'elle considère que la capacité représentationnelle (repérable pour un observateur au travers des accomplissements qu'elle permet) est corrélée à la sensibilité et constitue donc un indicateur fiable de sa présence chez un être ? Il me semble que non. Outre le fait que le lien entre conscience-représentation et conscience-subjectivité n'est jamais revendiqué, on trouve chez elle trop de passages qui reviennent à disqualifier toute volonté d'accorder une quelconque importance à l'expérience « à la première personne ». Ainsi, du commentaire qu'elle consacre (Proust, 1997 p. 32-48) à la « chambre chinoise » de Searle (voir encadré ci-contre), il ressort que l'objection de Searle n'est pas décisive parce qu'il montre seulement que l'Anglais n'a pas l'expérience subjective associée à la compréhension, ce qui n'est pas gênant car les traits essentiels à la formation de représentations peuvent être expliqués indépendamment de la qualité subjective de l'expérience. Ailleurs, elle écrit encore :
Je me suis demandé si je ne faisais pas un mauvais procès à Joëlle Proust en la soupçonnant d'avoir redéfini la notion d'esprit. N'adopte-t-elle pas plutôt une approche objective (extérieure) de l'esprit par nécessité, avec cependant pour projet d'œuvrer à la détection et la compréhension des états conscients comme expérience qualitative ? Voudrait-elle dire qu'elle considère que la capacité représentationnelle (repérable pour un observateur au travers des accomplissements qu'elle permet) est corrélée à la sensibilité et constitue donc un indicateur fiable de sa présence chez un être ? Il me semble que non. Outre le fait que le lien entre conscience-représentation et conscience-subjectivité n'est jamais revendiqué, on trouve chez elle trop de passages qui reviennent à disqualifier toute volonté d'accorder une quelconque importance à l'expérience « à la première personne ». Ainsi, du commentaire qu'elle consacre (Proust, 1997 p. 32-48) à la « chambre chinoise » de Searle (voir encadré ci-contre), il ressort que l'objection de Searle n'est pas décisive parce qu'il montre seulement que l'Anglais n'a pas l'expérience subjective associée à la compréhension, ce qui n'est pas gênant car les traits essentiels à la formation de représentations peuvent être expliqués indépendamment de la qualité subjective de l'expérience. Ailleurs, elle écrit encore :
Mais ce qui nous intéresse est moins ce que le sujet peut percevoir consciemment que l'information qu'il exploite dans son action, information qui peut donner lieu ou non à une expérience qualitative ; nous nous intéressons donc à la sensation, et aux propriétés du contenu sensoriel, uniquement en tant qu'elles véhiculent une information utilisable pour la formation de représentations dé-tachées de leur objet (Proust, 1997, p. 281).
Je suis reconnaissante à John Searle, dont la lecture m'a confirmé que le biais consistant à écrire des traités sur la conscience dont la conscience est absente existait bel et bien. On peut se reporter en particulier aux deux premiers chapitres de The Rediscovery of the Mind [16]. L'auteur y montre comment l'histoire récente du matérialisme se présente comme la répétition incessante à travers les écoles successives (béhaviorisme, théories de l'identité, fonctionalisme, théories inspirées des travaux sur l'intelligence artificielle...) de la même monumentale erreur : celle qui consiste, de façon plus ou moins avouée, à nier l'existence du mental, à donner l'impression de parler de l'esprit en ayant de fait évacué tout ce qui est constitutif de l'expérience même de la conscience [17] (le vécu subjectif).
Comment en est-on arrivé là ? À défaut de pouvoir reproduire l'analyse de Searle dans toute son extension, on mentionnera quelques-unes des raisons qu'il avance pour expliquer la négation du mental. L'une d'elles a trait à notre héritage culturel. La pensée moderne (qui se veut d'esprit scientifique) s'est érigée contre le dualisme cartésien (la distinction corps-âme), tout en conservant de la tradition cartésienne un vocabulaire dont le contenu est loin d'être neutre comme les partitions physique/mental ou matière/esprit. Il en est résulté que le simple fait de reconnaître l'existence de l'esprit est déjà perçu comme un abandon de la rationalité au profit d'un mysticisme de mauvais aloi. Quand on est matérialiste ou physicaliste, on soutient que tout est matière ou que tout est physique ; si parallèlement on maintient les partitions cartésiennes, alors on se croit tenu pour asseoir sa position de nier l'existence d'une réalité correspondant aux mots « esprit » ou « mental ».
À cela s'est ajouté le fait que l'on a retenu comme caractéristique de l'approche scientifique le fait qu'elle était objective, mais en confondant l'objectivité au sens épistémique (répondre à la question : comment connaître cette chose ?) et l'objectivité au sens ontologique (répondre à la question : qu'est cette chose ?). La science est objective par sa méthode dans le premier sens : elle aborde les choses « de l'extérieur » ou « à la troisième personne », dans un rapport entre un observateur et un objet d'étude. Lorsque l'objet d'étude est l'esprit (d'autrui), le chercheur se trouve par nécessité à l'extérieur du phénomène étudié. Mais cette objectivité forcée n'implique pas - comme cela a été fait - de nier que l'esprit a un contenu subjectif, qu'il est vécu « à la première personne ».
Ces raisons, et d'autres encore, ont été responsables d'une dérive scientiste qui - bien que dans un tout autre genre - n'a rien à envier aux considérations mystiques les plus farfelues relatives à la conscience. Elle a créé une propension tenace à vouloir évacuer comme apparence illusoire ce qui est l'expérience la plus immédiate et la plus incontestable de chacun : les sensations, les émotions, les qualia.
Quelqu'un pourrait objecter : n'est-il pas possible que la science découvre [...] qu'en réalité il n'existe rien de tel que des états mentaux qualitatifs intérieurs, que tout cela n'est qu'une illusion comme les levers de soleil ? Après tout, si la science peut découvrir que les levers de soleil sont des illusions systématiques, pourquoi ne pourrait-elle pas découvrir que des états conscients tels que la douleur sont également des illusions ? La différence est celle-ci : dans le cas des levers de soleil, la science ne nie pas l'existence du fait que le soleil apparaît comme se mouvant dans le ciel. Elle fournit plutôt une explication alternative de ce fait-là ainsi que d'autres faits. [...] On ne peut pas démontrer l'inexistence des expériences conscientes en prouvant qu'elles ne sont qu'une apparence déguisant la réalité sous-jacente, parce que concernant la conscience, l'existence de l'apparence est la réalité. Si je me sens exactement comme si j'avais une expérience consciente, alors je suis en train d'avoir une expérience consciente. [...] l'expérience de ressentir la douleur est identique à la douleur d'une façon dont l'expérience de voir un lever de soleil n'est pas identique à un lever de soleil (Searle, The Mystery of Consciousnes [18] p. 111-112).
L'objectif de la science est de parvenir à rendre compte de façon systématique de la façon dont le monde fonctionne. Une partie du monde consiste en des phénomènes ontologiquement subjectifs. Si nous avons une définition de la science qui nous interdit d'enquêter sur cette partie du monde, c'est la définition qu'il faut changer, pas le monde [19] (op. cit. p. 114).
La conscience c'est comme la digestion ?
 Searle est à la recherche d'une conception de l'esprit qui soit en accord avec l'état de nos connaissances mais aussi avec ce qu'indique le sens commun : indépendamment de toute référence à des travaux scientifiques, et de tout questionnement épistémologique (Comment fait-on pour connaître ceci ? Qu'est-ce qui prouve que cela ?), nous avons la certitude d'être conscients, la certitude que d'autres êtres (humains ou pas) le sont, et la certitude que la vie mentale a un rapport avec notre interaction avec l'environnement (C'est parce que j'ai vu l'eau bouillir que je crois qu'elle est chaude et que j'éteins le gaz).
Searle est à la recherche d'une conception de l'esprit qui soit en accord avec l'état de nos connaissances mais aussi avec ce qu'indique le sens commun : indépendamment de toute référence à des travaux scientifiques, et de tout questionnement épistémologique (Comment fait-on pour connaître ceci ? Qu'est-ce qui prouve que cela ?), nous avons la certitude d'être conscients, la certitude que d'autres êtres (humains ou pas) le sont, et la certitude que la vie mentale a un rapport avec notre interaction avec l'environnement (C'est parce que j'ai vu l'eau bouillir que je crois qu'elle est chaude et que j'éteins le gaz).
La position défendue par Searle est que les phénomènes mentaux résultent de processus neurophysiologiques ; ils sont des caractéristiques du cerveau. Selon une analogie qu'il aime à répéter, la pensée est un phénomène biologique, comme la digestion. La seule différence est qu'à ce jour elle est moins bien connue. La neurobiologie actuelle fournit déjà des corrélations précises entre des perceptions sensorielles, émotions, mémorisations, activités motrices... et des activités physico-chimiques de composantes du système nerveux. On n'a pas encore découvert comment les états du cerveau provoquaient des états qualitatifs subjectifs, mais on y parviendra probablement. Il n'y a pas un mystère de la conscience, mais un domaine d'investigation sur la conscience, qui est un projet de recherche scientifique comme un autre. Sans les errements liés à une mauvaise gestion de notre rapport à l'héritage culturel cartésien, il y a longtemps qu'on aurait compris que l'esprit est un domaine où « on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut être un « matérialiste intransigeant » sans contester le moins du monde l'existence de phénomènes mentaux (subjectifs, internes, intrinsèques et souvent conscients) » (Searle, 1992, p. 54).
Concernant la position de Nagel, Searle soutient à la fois que cet auteur a raison concernant l'irréductibilité de la conscience, et que cela n'a aucune conséquence dramatique. Il suffit pour s'en rendre compte de bien distinguer la question ontologique (qu'est-ce que c'est ?), de la question épistémique (comment connaître ?) et de la question causale (comment expliquer ?). Oui, la dimension subjective de la conscience restera irréductible, à moins qu'il n'intervienne une révolution dans nos connaissances et pratiques scientifiques. Cela concerne la réduction au sens ontologique : si on dit que la douleur n'est rien d'autre que telle activité neuronale, c'est faux. On a effectivement éliminé le ressenti « à la première personne », qui est le caractère essentiel de la conscience. Ce faisant on n'établit pas une équivalence selon laquelle « telle activation des neurones » est la même chose que « aïe ! aïe ! aïe ! », on procède à une redéfinition du mot douleur dont la sensation est exclue. Mais admettre cela n'a que des conséquences triviales et ne conduit nullement à un bouleversement de notre conception de l'univers ou de notre approche scientifique du réel. Sur le plan épistémique, il en découle simplement que la façon dont nous accédons à la connaissance de notre propre douleur (à la première personne) est différente de celle dont nous prenons connaissance de la douleur d'autrui (à la troisième personne). L'irréductibilité ontologique n'interdit pas la réduction causale, celle qui conduit à affirmer que la douleur est provoquée par tel état du système nerveux.
Searle s'est spécialisé depuis plus de vingt ans dans la philosophie de l'esprit. Si j'avais découvert ses livres il y a six mois, j'aurais probablement adhéré à l'ensemble de ses thèses. Parce que ses raisonnements et son écriture sont limpides, mais aussi parce que j'y aurais reconnu, sous une forme plus achevée, ma propre conception de ce qui constitue la façon la plus satisfaisante de réunir nos croyances et connaissances concernant la conscience. Maintenant, j'ai un doute. Il tient à une chose en « isme » rencontrée dans mes lectures.
La pensée inopérante sur le monde ?
Pour Searle, la conscience est une propriété émergeante du cerveau (du système nerveux). L'expression « propriété émergeante » peut inspirer une méfiance légitime tant on a abusé de la formule « le tout est plus que la somme de ses parties » pour déguiser en explication le postulat de surgissement miraculeux de propriétés liées à la « complexité » d'un système. Comme le soulignait Karl Popper, l'aspect intelligible de la formule se réduit à une banalité : « Même trois pommes sur une assiette sont “plus qu'une simple somme” dans la mesure où il existe certaines relations entre elles (la plus grosse peut être ou ne pas être entre les deux autres, etc. [20] ». Mais Searle n'est pas de ceux qui font des propriétés émergentes un usage flou et suspect. Il emploie cette notion dans son sens banal et intelligible : une propriété est émergente quand elle appartient à un système et non à ses composantes, et qu'elle s'explique entièrement par ses composantes et leur interaction. Par exemple, la solidité n'est pas une propriété des molécules, mais une propriété d'ensembles de taille supérieure expliquée par des mouvements vibratoires des molécules dans certaines structures.
Tout semble clair. La conception de Searle s'accorde avec nos connaissances aussi bien immédiates que scientifiques : le cerveau provoque la conscience, c'est-à-dire des états subjectifs, qui eux-mêmes comptent parmi les facteurs causant les actions des sujets qui les éprouvent. À moins que... l'on bute sur l'épiphénoménisme. Cette théorie ne nie pas la réalité du mental, mais affirme qu'il n'a pas prise sur les événements non mentaux (appelons ces derniers « physiques » pour abréger). Le mental est causé par le physique, mais il n'en est qu'un effet accessoire (un épiphénomène), dans le sens où il ne peut pas en retour agir sur lui. Si l'épiphénoménisme est vrai, alors le fait que vous ayez envie d'un café n'est en rien responsable du fait que vous mettiez en route la cafetière.
Il existe de nombreuses doctrines à la fois irréfutables et irrecevables : on ne sait pas prouver qu'elle sont fausses, et il nous est impossible de les tenir pour vraies. Même ceux qui les professent se comportent comme s'ils n'y croyaient pas. Dans le domaine de la philosophie de l'esprit, on peut citer par exemple le solipsisme (seul mon esprit existe) ou le panpsychisme (tout ce qui existe, des atomes aux galaxies, est doué d'une vie mentale). L'épiphénoménisme peut passer pour un représentant parmi d'autres de cette famille de théories curieuses. Mais outre la caractéristique de ne pouvoir être réfuté, il semble présenter de surcroît la propriété d'être conforté par les façons qui nous paraissent les plus raisonnables de rendre compte de la conscience. Searle pour sa part estime qu'il n'en est rien :
Le fait que les états mentaux soient survenants [21] sur [supervenient on] les caractéristiques neuronales ne diminue en rien leur efficacité. La solidité du piston est causalement survenante sur sa structure moléculaire, mais cela ne rend pas la solidité épiphénoménale... (Searle, 1992, p. 126)
À tort peut-être, j'ai un doute sur le fait que cette analogie suffise à nous tirer d'affaire. Certes, le piston a un rôle causal dans le fonctionnement du moteur. Mais il n'est rien d'autre qu'un certain arrangement de molécules. On dit exactement la même chose en affirmant que le piston comprime le mélange explosif dans le cylindre ou en disant que c'est l'arrangement de molécules qui le compose qui le fait. Pour pouvoir transposer au cas qui nous intéresse, il faudrait pouvoir dire : les états mentaux ne sont rien d'autre que des états neuronaux. Mais on a convenu plus haut que cela était exclu si l'on voulait faire place à la réalité indéniable du mental.
La réduction ontologique du piston à un arrangement de molécules est possible, la réduction (ou l'identification) de la subjectivité à un arrangement de neurones ne l'est pas. Par ailleurs, l'arrangement de neurones et les variations de son état semblent suffisants pour expliquer le déclenchement de tels mouvements des muscles et du squelette. On dirait bien que la seule issue qui reste est celle-ci :
- On a d'un côté des enchaînements physiques (non mentaux) qui se suffisent à eux-mêmes.
- Par ailleurs, puisque le mental existe, et qu'on a maintes indications de sa corrélation avec les états du système nerveux, c'est qu'il est causé par ceux-ci.
- Et comme les faits physiques épuisent l'explication des enchaînements d'événements physiques, c'est que le mental n'a aucune influence sur le physique. Nous sommes des automates conscients.
Mon envie de vous faire part de ma perplexité face à la solidité de l'hypothèse épiphénoméniste, n'a rien à voir avec le fait que mes doigts tapent cette phrase sur le clavier. CQNFPD [22].
Bizarrement, partis d'une position purement matérialiste, on débouche sur une sorte de dualisme. Descartes, en posant d'entrée l'existence de deux substances différentes, ne parvenait pas à produire une explication recevable de la façon dont l'âme réussissait à mouvoir le corps. Ici, alors qu'on a fait l'hypothèse que le mental émanait du physique (d'une façon qu'on ne comprend pas encore mais que la science expliquera un jour), on semble de nouveau acculé à ne pouvoir faire la jonction dans l'autre sens : du mental vers le non mental.
Aurais-je une crise de mystérianisme ? Toujours est-il que j'éprouve de la sympathie pour cette réflexion de Nagel :
Ce serait une erreur de conclure que le physicalisme doit être faux. [...] Il serait plus exact de dire que le physicalisme est une position que nous ne pouvons pas comprendre parce qu'à présent nous n'avons pas la moindre idée de la façon dont elle pourrait être vraie. Peut-être trouvera-t-on déraisonnable de faire de cela un préalable à sa compréhension. Après tout, pourrait-on dire, le sens du physicalisme est suffisamment clair : les états mentaux sont des états du corps ; les événements mentaux sont des événements physiques. [...] Je pense que c'est précisément l'apparente clarté du verbe « être » qui est trompeuse. Ordinairement, quand on nous dit que X est Y nous savons comment cela est supposé être vrai, mais cela dépend d'un arrière plan théorique qui n'est pas fourni par le « est » à lui seul. Nous savons [...] le genre de choses auxquelles X et Y renvoient, et nous avons une idée grossière de la façon dont les deux chemins auxquels ils renvoient pourraient converger en une seule et même chose [...]. Mais quand les termes de l'identification sont très disparates, il se peut que la façon dont elle pourrait être vraie ne soit pas si claire que cela (Mortal Questions, p. 177).
Se pourrait-il que dans la phrase « les faits mentaux sont des faits physiques », l'obscurité ne soit pas tant dans le terme « mental », ni ne réside entièrement dans l'incapacité à donner un contenu à « être », mais qu'elle provienne aussi de l'inadéquation de notre conception du « physique [23] » ?
Conclusion en quenouille
De tout cela je ne conclus rien, faute de recul ; ma connaissance des approches scientifiques ou philosophiques de l'esprit est trop récente et étroite. Retenez surtout qu'il vaut la peine de consulter les ouvrages évoqués dans ce texte et, plus largement, qu'il vaut la peine de se promener dans la littérature consacrée à la conscience.
Les inconnues qui demeurent en ce domaine disparaîtront-elles grâce à la marche ordinaire de la recherche ? Les paradoxes qu'on y rencontre ne sont-ils que le symptôme de questions mal posées ? Peut-être.
Mais il se pourrait aussi que les théories dérangeantes que l'on trouve dans diverses branches contemporaines de la philosophie de l'esprit ne soient pas entièrement imputables à des divagations oiseuses, ou à un malheureux héritage du passé. La floraison d'écoles qui écartent la subjectivité du discours sur la conscience, ou qui pour certaines vont jusqu'à la désigner comme une illusion, pourrait être une réponse aberrante à un problème réel : l'impossibilité de trouver une façon cohérente d'articuler nos intuitions immédiates avec les connaissances dont on dispose sur l'esprit. La solidité de l'hypothèse épiphénoméniste, dont tout le monde aimerait pourtant se débarrasser, est un autre indice du malaise. Peut-être tout cela est-il le signe qu'un traitement satisfaisant de la sensibilité ne pourra pas être atteint sans un bouleversement de notre conception même de ce qu'est une approche scientifique.
La sensibilité est un critère central de l'éthique antispéciste, de l'éthique tout court. Ce que l'on en sait n'est pas rien : toutes disciplines confondues (éthologie, psychologie, neurobiologie...), les connaissances scientifiques actuelles plaident en faveur de la reconnaissance d'une sensibilité et d'une pensée animales. Les arguments avancés par ceux qui persistent à en contester l'existence ne résistent pas à la critique. Et cependant, il semble que le sol se dérobe lorsqu'on tente de « caser » convenablement la subjectivité dans l'ensemble de notre vision du monde. Que l'on en sorte à la fois rassuré et inquiet n'est pas une mauvaise chose. Mieux vaut avancer dans le doute qu'armé de fausses certitudes. De vraies certitudes feraient encore mieux l'affaire, mais je n'ai pas cela en rayon.
[1] Références complètes des titres cités : Marc D. Hauser, À quoi pensent les animaux ?, Odile Jacob, 2002 (335 pages, 26 €). Dominique Lestel, Les origines animales de la culture, Flammarion, 2001 (368 pages, 20 €) ; paru également chez Le livre de poche en 2003 (8 €). Joëlle Proust, Comment l'esprit vient aux bêtes. Essai sur la représentation, Gallimard, 1997 (395 pages, 23 €).
[2] De façon surprenante par rapport à sa réserve dans l'analyse de sujets de dimension plus restreinte, Hauser exprime une opinion (qui reste révisable toutefois) sur deux grandes questions : la conscience de soi (chapitre 5) et le sens moral (chapitre 9). Dans les deux cas, il penche pour l'inexistence de ces facultés chez les non-humains. Le chapitre 5 (assez succinct) accorde une importance qui peut sembler excessive à la capacité de se reconnaître dans un miroir. Le chapitre sur le sens moral est plus riche par la diversité
d'observations sur le terrain et d'expériences qui y sont rapportées. La conclusion négative de l'auteur ne tient pas à l'absence chez les non-humains de comportements ayant toutes les apparences de l'altruisme, ou du respect de conventions, mais à des considérations qui restent assez spéculatives sur l'absence ou l'insuffisant développement chez eux des capacités nécessaires à un véritable sens moral.
[3] En référence à la célèbre théorie développée par Thomas Kuhn dans La structure des révolutions scientifiques (Flammarion, 1972). Kuhn montre notamment que les paradigmes scientifiques ont une énorme capacité de résistance, qu'ils persistent longtemps avant d'être renversés et supplantés par d'autres, alors même qu'ils sont visiblement mis en défaut par une accumulation d'anomalies (de faits qui contredisent les lois ou prédictions du corpus théorique dominant dans un domaine).
[4] Le numéro spécial que la revue Etica & Animali a consacré au thème de la personne non humaine (Etica & Animali, 9/98, special issue « Nonhuman Personhood ») contient notamment deux études de ce type : l'une sur les dauphins (de Denise L. Herzing et Thomas I. White) et l'autre sur les éléphants (de Joyce H. Poole). Ce numéro, bien qu'édité en Italie, est entièrement rédigé en anglais. Les contributeurs en sont tous des spécialistes reconnus dans leur domaine (éthologie, philosophie ou psychologie).
[5] Steven Wise, Rattling the Cage, Profile Books, 2000.
[6] Gómez a exposé sa propre position sur ce sujet dans « Are Apes Persons ? The Case for Primate Intersubjectivity », Etica & Animali, 9/98, p. 51-63.
[7] J. Proust est philosophe et directrice de recherche au CNRS.
[8] Je signale l'aridité de ces textes pour prévenir les lecteurs que rebutent les ouvrages un peu difficiles, et nullement pour en décourager la lecture. Au contraire, pour ceux qui en ont le loisir, il vaut la peine de consulter la version longue qui révèle mieux la progression du raisonnement de Joëlle Proust. De surcroît, Comment l'esprit vient aux bêtes inspire la gratitude que l'on peut éprouver pour quelqu'un qui prend la peine d'exposer et de commenter les thèses de nombre d'auteurs que soi-même on ne connaît pas, ou mal.
[9] Sauf erreur de ma part, ce thème n'apparaissait pas du tout dans les quelque 400 pages de Comment l'esprit vient aux bêtes.
[10] Dans sa contribution au numéro 108 de la revue Le Débat (janvier-février 2000) intitulée « Cognition animale et éthique ».
[11] Ils sont selon Proust capables de former des « proto-représentations » qui leur permettent jusqu'à un certain point de réagir de façon flexible à leur environnement, mais ils n'ont pas les moyens de saisir cet environnement comme existant indépendamment de leurs perceptions sensorielles immédiates.
[12] « Qu'est-ce que cela fait d'être une chauve-souris ? ». Initialement paru dans la Philosophical Review (vol. LXXXIII, oct. 1974), l'article est repris dans Mortal Questions (Thomas Nagel, Cambridge University Press, 1979). Il existe une traduction française de ce livre (Questions mortelles, PUF, 1983) mais elle est épuisée.
[13] Lui-même utilise dans d'autres textes des connaissances issues de la neurobiologie pour alimenter sa réflexion (Voir par exemple le chapitre 11 de Mortal Questions où il s'appuie sur les données relatives aux individus dont les deux hémisphères cérébraux ont été disjoints pour mettre en doute l'unité de la conscience (y compris chez les sujets au cerveau intact).
[14] Le terme « réduction » peut sembler obscur. Il désigne le processus consistant à partir d'un objet ou événement observable, et à lui substituer d'autres éléments (généralement moins immédiats) supposés à la fois être équivalents à l'objet de départ, et fournir une explication causale à son sujet. Par exemple, on procède à une réduction quand on décrit un grain de sable comme une collection d'atomes liés par certaines relations.
[15] À la différence des béhavioristes, les fonctionnalistes utilisent des termes du vocabulaire mental tels que « désirs », « croyances », « intentions », mais de telle sorte qu'ils ne désignent rien en eux-mêmes. Ils sont des noms donnés à des points dans le réseau d'interdépendances qui conduit de l'input à l'output, et sont définis exclusivement par les relations qu'ils entretiennent avec d'autres points. Ainsi le désir « ne pas se mouiller » peut être saisi comme un élément qui, associé à d'autres éléments tels que l'input sensoriel « vision de gouttes », et la croyance « je suis dehors », conduit à l'action « ouvrir un parapluie ».
[16] Éd. The MIT Press, 1992. Il existe une traduction française de ce livre : John Searle, La redécouverte de l'esprit, Gallimard, 1995 (25 euros). À noter que Searle est également l'auteur d'un article intitulé « Animal Minds » (Esprit animal) paru dans le numéro 9/98 d'Etica & Animali.
[17] Ted Honderich offre également une présentation et une analyse critique des nombreuses écoles qui traitent de la conscience « en regardant ailleurs » dans le chapitre 2 de son Mind and Brain (Clarendon Press, Oxford, 1988).
[18] Éd. Granta Books, 1997.
[19] Dans ces deux passages, Searle vise plus particulièrement le philosophe Dan Dennett. Précisons que Proust quant à elle ne nie pas la réalité de l'expérience subjective. Elle se contente de l'exclure du champ de ses préoccupations.
[20] Popper, Misère de l'historicisme, Plon, 1956, p. 84.
[21] Une propriété M est survenante sur une propriété P d'un objet s'il ne peut y avoir de changement de M dans cet objet sans qu'il y ait un changement de P. Appliqué au cas qui nous occupe, cela signifie qu'un changement de l'état mental d'un individu ne peut se produire sans changement de son état neurophysiologique. C'est pour Searle une autre façon de dire que les phénomènes neuronaux causent les phénomènes mentaux.
[22] Ce qu'il ne fallait pas démontrer.
[23] Quelques échanges avec David m'ont fait sentir que l'interprétation de la physique moderne (et même classique) soulevait des problèmes redoutables relatifs aux fondements de la connaissance et à la notion de réalité. Je m'abstiendrai de traiter ici d'un sujet que je ne maîtrise pas. Au demeurant, il sera probablement question de physique dans l'article de D.O. que vous trouverez dans ce numéro et qui est en train de s'écrire pendant que j'achève celui-ci.






 Une mine de ressources
Une mine de ressources